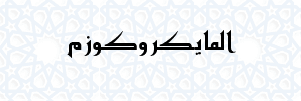Parcours foucaldien
par Z. Imahawen
Toute sa vie, Michel Foucault a remis en cause les idées reçues sur la prison, la folie, l’hôpital, la littérature... Itinéraire d’un philosophe différent qui affirmait : « Les révolutions éthiques sont les plus prometteuses ».
_________________________________________________________
1956, Uppsala - 1958, Varsovie - 1959, Hambourg : Une histoire de la folie à l’âge classique
C’est en philosophe qui a la bougeotte que Michel Foucault écrit de la Suède à l’Allemagne, via la Pologne, son premier grand livre. Or comme il arrive souvent pour les philosophes professeurs, leur premier grand livre est une thèse. Foucault a alors à peine trente ans. Le sujet de la thèse : Une histoire de la folie à l’âge classique. C’est là un travail à première vue tout ce qu’il y a de plus éloigné de la philosophie et qui se rapproche bien plutôt d’une thèse de psychiatrie. Or il n’en n’est rien. Ce serait commettre une grave erreur historique que de confondre l’histoire de la folie et l’histoire de l’institution de l’hôpital des fous qui commence, il y a deux siècles. La folie a une longue histoire.
C’est faire exploser une bombe que de soulever le rapport entre un certain discours tenu par la société et la mise en place de certaines institutions. C’est ainsi que le discours de la folie au XVIIe et au XIXe siècle change. Au XVIIe siècle apparaissent en effet les maisons d’internement pour les fous. Mais qui sont les « fous » d’alors ? Pas seulement ceux qui ont un grain, un véritable grenier parfois, mais aussi et surtout même, des marginaux, des oisifs, des individus qui font désordre dans la société, des pauvres. Les fous ce sont donc des hors la loi. Au nom de la morale et au nom d’un certain culte du travail bourgeois, on enferme. L’homme moderne de l’époque, l’honnête homme, croit fanatiquement aux prétentions de la raison. Le discours de la folie est donc un discours de la raison qui refuse la folie comme la peste. Le XVIIe siècle, c’est l’époque de Descartes, Galilée. C’est dans ce contexte que Foucault comprend la phrase de Descartes : « Mais quoi ? ce sont des fous ! », qui sonne la gloire de la raison et l’exclusion des fous.
Au XIXe siècle, on « libère de leurs chaînes », selon l’expression de Pinel (un des inventeurs de la psychiatrie) ceux qui ont toute leur tête. On s’interroge alors sur ce qui rend autre l’individu : aliéné, l’individu va contre la norme. La psychiatrie est née : elle aura pour but de réintégrer l’individu dans la société, dans ses normes. La naissance de l’institution de l’hôpital a donc pour fin de rendre normal l’individu en comprenant les causes de son désordre (conçu comme désordre mental). Les psychiatres sont des guérisseurs de l’âme.
Le travail ouvert par Foucault est un travail de description des représentations profondes dans lesquelles la société occidentale s’est élaborée à travers des pratiques institutionnelles. Avec cette thèse sur la folie, on a là le premier signe d’une philosophie qui veut sortir du cadre disciplinaire, de la norme en montrant comment elle régit nos vies à tous.
1966, Paris : La critique des sciences de l’homme
La réflexion sur la folie conduit alors Foucault à remettre en cause tout le savoir de l’homme : ce que l’on appelle, depuis le début du XIXe, les « sciences de l’homme ». C’est d’elles que l’humanisme se réclame haut et fort. De son côté, Foucault décrète la mort de l’homme.
Foucault entend se départir du discours de l’humanisme. Non pas qu’il soit dépassé, qu’après Auschwitz nous ne puissions plus parler de l’homme (ni de Dieu d’ailleurs). Mais la critique de la psychiatrie est valable pour les sciences de l’homme.
Dans les Mots et les choses, Foucault indique que les sciences de l’homme apparaissent au même moment que la psychiatrie : elles servent le même projet. Elles ont les mêmes présupposées : celui d’une « nature » de l’homme. Que demande les sciences de l’homme, sinon la vérité de l’homme ? C’est la même question que pose le psychiatre : qu’est-ce que le fou, l’homme fou ? C’est la même démarche psychologique qui se répète et qu’on retrouve à tous les niveaux, dans toutes les disciplines des sciences de l’homme. Notre société souhaite de tous ses vœux l’homme, elle le désire, elle a cette « volonté de tout savoir » de lui et pourtant son discours sert à cautionner des enfermements.
On comprend pourquoi Sartre, le porte-parole d’un humanisme pris à sa source, qui affirme la liberté absolue de l’homme, est celui qui a le plus mal compris son époque. Foucault, au contraire, montre que l’homme n’est qu’une invention récente - né avec les sciences de l’homme. Le discours de Foucault est donc à comprendre comme un discours de rupture avec le discours humaniste, incapable de se penser historiquement. Mais ce faisant il va plus loin encore, en annonçant sa mort prochaine. Cette annonce a été mal comprise : on n’y a vu un discours fasciste. Mais Foucault ne fait rien d’autre que de constater le changement de discours : nous sommes encore des humanistes jusqu’au moment où il devient possible d’être en rupture, de penser les implications assujettissantes des sciences de l’homme. Aussi la critique de l’homme par Foucault est-elle à concevoir comme un discours de libération. Foucault propose une voie de sortie à l’individu, face à la norme institutionnelle de l’homme, de l’Université.
Foucault en effet va plus loin. Il ne se contente pas seulement de critiquer l’homme, ou plutôt toutes les sciences et philosophies de l’homme. Le sous–titre du livre de 1966 est significatif sur ce point : « archéologie des sciences humaines ». Foucault place son propre discours en rupture avec le discours en place dans notre société moderne. Et si cela est possible, c’est parce que Foucault, comme il le montre déjà dans ce livre – oppose un autre visage à la modernité : un visage critique. L’archéologie, nom donnée à cette position critique, permet de se mettre en écart, de critiquer le visage anthropologique de la modernité qui s’est imposé. Ainsi est signée la mort de l’homme.
L’archéologie propose une pensée sans sujet, une pensée non psychologisante. C’est le nom donné à cette démarche historique qui cherche à sonder les structures du savoir. L’archéologie se servira donc de nouveaux instruments conceptuels : plutôt que la continuité, ou l’évolution, propres à des philosophies de l’histoire « psychologisantes », l’archéologie choisira la discontinuité en découpant des tranches historiques pour les décrire ; plutôt que de parler de la conscience humaine, Foucault choisit de parler de système, de structures ; plutôt que de sujet qui fait l’histoire, il faut se résoudre à une histoire sans sujet. Foucault définit comme moteur de cette histoire l’institution, qui contraint l’homme et l’enferme dans une normalité rigoureuse : cette institution prend le visage de l’asile, d’aliéné, mais aussi de la prison, l’hôpital ou l’école. Il faut, dit Foucault, «être respectueux quand une singularité se soulève, intransigeant quand le pouvoir enfreint l’universel ».
A la fin des années 60, abandonnant pour quelque temps la question du « savoir », Foucault commence à s’intéresser au « pouvoir ». Cet intérêt, on va voir, va le mener à dépasser les conceptions traditionnelles de l’Etat, et aussi à affronter une autre « expérience », bien plus terrifiante que l’Asile ou l’Hôpital (la clinique) : il s’agit de la prison, reine des institutions.
1967- 68, Tunis : Le philosophe et le pouvoir
Jusqu’ici Foucault ne parlait pas du pouvoir, refusait même d’affronter ce genre de question : psychiatrie, savoir constituaient son seul univers. Il faudra attendre quelques années pour que son discours s’inverse et qu’il ne parle plus que de cela : montrant que le pouvoir est « l’autre côté » du savoir. Mais avant, il faut qu’il éprouve le pouvoir. Or l’expérience du pouvoir, Foucault n’en prend vraiment conscience qu’à l’époque où il intègre l’E.N.S, le fleuron des études supérieures, en 1946.
Normalien, Foucault souffre en effet du regard porté sur son homosexualité. Il souffre aussi du lourd travail que l’Ecole l’oblige à endurer. C’est l’enfer quotidien pour ce jeune homme maigre et nerveux. Foucault réagit par « la fuite » : expéditions nocturnes et clandestines ; problème latent d’alcoolisme (dont il prendra vite conscience heureusement) ; asociabilité à cause de son cynisme ; crise « intense » de paranoïa. Sans doute, aussi, son choix de voyager en tant que lecteur dans plusieurs universités étrangères est une façon d’entériner cette fuite. Foucault accepte de suivre durant quelques temps des séances de psychiatrie, en même temps qu’il l’étudie pour ses recherches : sciemment, il se confie à la psychologie.
Tunis n’est pas le premier voyage qu’il fait hors de France, mais à coup sûr, il est un déclencheur : Foucault ne pourra plus ne pas penser à la question politique. Il séjournera là-bas deux années et donnera des cours à l’université. Foucault est vite confronté aux durs événements de la politique - 1967 est une année de grand trouble : affrontements, arrestations, émeutes, « pogrom » (la question palestinienne enflamme les esprits). Son action restera discrète, mais il réagit aux arrestations de certains de ses étudiants. A plusieurs reprises, il aidera les étudiants : hébergeant quelques militants, faisant imprimer des tracts révolutionnaires chez lui. Bien sûr ce ne sera pas un engagement au sens fort, mais il participe à sa manière à la révolte, non sans être malmené à plusieurs reprises par les autorités tunisiennes. C’est ainsi que l’épreuve de la politique commence pour lui.
1968-69, Vincennes : Enseigner autrement
De retour en France, qu’il ne quittera que pour quelques voyages, on lui propose d’enseigner à Vincennes, université aux « nouvelles méthodes d’enseignement».En acceptant, Foucault espère pouvoir enseigner autrement. Cette université libre - où il serait possible d’enseigner ce qu’il veut - se révèle au bout du compte une vraie tromperie. 1969 : l’année qui débute par des troubles ultra-gauchistes dans les universités là même où les étudiants, quelques mois plus tôt, en Mai, avaient fait la « révolution ». Vincennes fonctionne comme une poudrière. Elle développe un climat de tension qui enflamme d’autres universités. A Vincennes, 34 étudiants seront exclus et 181 autres menacés de poursuite. Le 10 février, un grand meeting a lieu, à la Mutualité, pour protester contre « la répression calculée » des forces de l’ordre. Les cours continuent pourtant. Mais le 15 janvier 1970, Olivier Guichard, alors ministre de l’Education, déplore les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’année écoulée à Vincennes, et surtout dénonce le caractère « marxiste-léniniste » des enseignements donnés - en tous cas, ultra-gauchistes (car peu des professeurs sont membres du Parti) - et décide de supprimer « l’habilitation nationale » des diplômes décernés en philosophie dans cette université. La réplique de Foucault est immédiate et d’une grande véhémence : « qu’on me dise clairement, ajoute-t-il, ce qu’est la philosophie et au nom de quoi, de quel texte, de quel critère, de quelle vérité, on rejette ce que nous faisons (...) Qu’est-ce que la philosophie (la classe de philosophie) a de si dangereux pour qu’il faille avec tant de soins la protéger ? Et qu’y a-t-il chez les Vincennois de si dangereux ?». (Le piège de Vincennes, Le Nouvel Observateur, 9 février 1970) Vincennes était un piège : loin de vouloir leur laisser un espace de liberté, les autorités ont voulu « prendre » la pensée militante dans des filets. Vincennes, en définitive : une prison. Pour Foucault, il n’y a jamais eu qu’une illusion de liberté. C’est peut-être de ce jour-là qu’il éprouvera cette présence constante, cette surveillance continue du pouvoir, dont il va parler bientôt dans Surveiller et Punir (1976), et qui ne cessera de le hanter jusqu’à sa mort.
Au bilan, Vincennes est une action politique collective, qui durera - pour lui - deux années. Foucault, sortira de là transformé : il opte définitivement pour un militantisme ultra-gauchiste. On ne peut pourtant pas le qualifier de marxiste, ni d’anarchiste. « Non, je ne m’identifie pas aux anarchistes libertaires, parce qu’il existe une certaine philosophie libertaire qui croit dans les besoins fondamentaux de l’homme. Je n’ai pas envie, je refuse surtout d’être identifié, d’être localisé par le pouvoir» ( Dits et Ecrits, Tome 4, p.667).
Pour lutter véritablement contre le pouvoir, Foucault va devoir passer par l’expérience réelle de la révolte. C’est elle qui va lui donner les instruments conceptuels adéquats pour se battre.
1971, Paris : Le philosophe contre le pouvoir
La véritable opposition, la lutte, la révolte contre le pouvoir commence avec la création du G.I.P, Groupe d’intervention des prisons. Avec quelques militants, Foucault se rend dans les prisons : c’est la première fois que l’on y entre librement. Le but de Foucault est clair. Il le rappelle en ces termes : « Nous voudrions littéralement donner la parole aux détenus. Notre propos n’est pas de faire œuvre de sociologue ni de réformiste. Il ne s’agit pas de proposer une prison idéale, je crois que par définition la prison est un instrument de répression ».
L’action du G.I.P. est très concrète : visites fréquentes auprès des détenus ; enquêtes sur les conditions d’incarcération ; manifestations de protestations en faveur des détenus ; aides aux détenus (dont la parole donnée n’est pas des moindres) ; aide à la préparation politique des procès des emprisonnés. Un manifeste brûlant, offensif, sera même diffusé à la chapelle Saint-Bernard de Montparnasse, le 8 février 1971. Foucault doit comparaître devant un tribunal pour impression de tracts sans mention d’imprimerie.
1975-76, Paris : Contre-discours, contre pouvoirs
Sans aller dire qu’il théorise à partir de la pratique, Foucault apprend, il découvre ce qu’est au fond le pouvoir par la lutte des prisons. Il est donc naturel que Foucault consacre un livre à la question des prisons. La prison est un phénomène récent. Il naît à peu près au même moment que l’hôpital. C’est dans Surveiller et Punir qu’il décrit cette expérience et surtout comment la prison a changé la condition du criminel. La détention remplace l’exécution, la cellule, le supplice. Il ne s’agit plus de tuer, mais de punir. « S’efface donc, au début du XIXe siècle, le grand spectacle de la punition physique (…) on entre dans l’âge de la sobriété punitive ». Foucault décrit comment cette machine à punir est en fait le monstre le plus redoutable du pouvoir moderne, que rien ne peut justifier, sinon ceux qui croient aux vertus du pouvoir. Mais qu’est-ce qu’apporte la prison, sinon une plus subtile souffrance, sourde, à l’intérieur des murs, sinon un calvaire sans fin d’hommes qu’on prive de tout droit d’être encore des hommes, alors qu’on remarque pourtant qu’il n’y a que l’homme pour commettre des crimes.
Foucault veut analyser cliniquement ce modèle de vertu qu’est soi disant la prison. C’est en se fondant sur la lecture de Bentham, un philosophe du XIXe siècle, qui chercha à imaginer une prison parfaite, que Foucault veut saisir la logique profonde du pouvoir.
Le propre du pouvoir n’est pas de juger (en dépit de l’hémorragie apparente des procès, des mises en examen, des « pouvoirs » du judiciaire sur l’exécutif), mais d’exercer une surveillance continue sur l’individu. Ce qui caractérise le pouvoir moderne, ce n’est pas d’agir par intermittence, comme le roi jadis sur ses sujets, mais c’est un contrôle en permanence. Le pouvoir est immanent à la société, il n’est pas dans une sorte de lieu, au dessus de la société, et qui la régirait. L’originalité de Foucault, c’est de mettre fin à une image transcendante, en surplomb du pouvoir.
La question n’est plus qui tient les rênes du pouvoir : le président, les juges, les capitalistes. Mais comment s’exerce le pouvoir qui touche chacun de nous que nous soyons simple cuisinier ou que nous soyons le Président. Le pouvoir est omniprésent et universel. Personne n’échappe à son emprise.
C’est notamment dans Surveiller et punir et la Volonté de Savoir, écrits respectivement en 1975 et 1976, que Foucault déploie cette logique du pouvoir. Le pouvoir se profile comme un « réseau de forces », plutôt que comme l’action d’une classe, ou d’un appareil d’Etat. L’expérience du G.I.P révèle à Foucault combien le pouvoir est partout dans la société et continuel : le détenu n’est pas soumis à la force au moment où il est intercepté après son crime jusqu’à sa mise en détention. Derrière les murs de la prison, il est obligé de suivre des ordres, il est soumis à une surveillance nuit et jour, 24 heures sur 24. Malgré lui le détenu voit progressivement que le monde carcéral est un monde, certes, en retrait de la société des autres hommes, mais en même temps purement utopique. C’est un non-lieu, le lieu même de la Loi. Tout geste est contrôlé, interprété.
Mais le pouvoir s’exerce aussi hors les murs de la prison. Partout : à l’armée, à l’école, dans le foyer familial. Des stratégies bien différenciées à chaque fois guident le pouvoir défini comme « capillaire » (puisqu’il fonctionne comme autant de « micro-pouvoirs » installés dans les moindres parcelles de la société). Le but : établir un contrôle du corps du détenu, du soldat, de l’écolier, de l’enfant, de l’homme d’entreprise. Le pouvoir contrôle tout dès notre naissance : ne naissons-nous pas dans les hôpitaux ? Le pouvoir est topologique, à la surface de l’architecture, dans la géographie du cadastre.
Ces forces du pouvoir sont apparues dans leur disposition de contrôle au XIXe siècle. Ce sont les disciplines - sortes de procédures, de stratégies du pouvoir - qui tiennent et s’imposent à l’individu. Le discours de l’homme, de ses droits surtout (qu’on pense à l’impact très grand que peut avoir pour tout un chacun la déclaration des droits de l’homme) ont servi, en quelque sorte, d’écran pour faire passer la pilule. Les sciences de l’homme sont devenue le « discours du pouvoir ». Il n’y a qu’à voir les ministres invoquant leurs experts techniciens en droit, économie, santé…pour en avoir la preuve sous les yeux. Foucault approfondit ainsi sa critique de l’humanisme, qui à tout vent sort les arguments du droit, de la souffrance. Mais quel droit (le droit à toutes les sauces : droit de vote, droit des femmes, droit des homosexuels, droit à la différence)?, quelle souffrance ? Tout est normalisé. Arendt dirait peut-être « banalisé ». Car il faut que la dignité humaine soit reconnue, que toute souffrance aussi soit prise en compte.
Ainsi, de nos jours, les « corps » deviennent l’élément sur lequel s’appliquent les forces du pouvoir, tandis qu’elles impriment à l’esprit le discours de l’homme. On est loin de la grille de lecture marxiste pour qui le pouvoir dominateur « aliène » les consciences. Le pouvoir est comme une toile d’araignée enserrant les individus, les tenant prisonniers et leur vomissant un suc gastrique pour les digérer, se les assimiler. Ou encore, une ruche où chaque abeille est au service de la Reine, sans que celle-ci finalement y soit pour quelque chose : tous, des « automates spirituels » ! La logique du pouvoir développé par Foucault se veut « normative », c’est-à-dire immanente à la société tout entière, dont l’exemple des disciplines militaires donnent sans doute une bonne idée.
En conséquence, l’opposition au pouvoir sera aussi « locale », en situation : elle ne peut être contre l’Etat de toute façon, car elle doit s’exercer au niveau même de la société.
Foucault cherche dès lors dans ses Cours au Collège de France, notamment dans « Il faut défendre la société », des moyens de contrer ce Discours envahissant et ce Pouvoir qui lui colle à la peau.
Il parle de tous ces hommes, historiens, aventuriers qui par leurs écrits ont essayé de réécrire l’Histoire officielle, l’Histoire du pouvoir, qui bien avant d’être intégrés dans les sciences humaines étaient déjà au service du pouvoir, de ces formes moins élaborées, plus primitives comme le pouvoir monarchique, le pouvoir féodal, notamment.
Des contre-discours ont existé, tentant d’ébrécher un peu ces monuments aux morts, ces monuments glorieux du pouvoir qui chantent les victoires des rois, des vainqueurs. Mais ces contre-discours ne semblent pas avoir un souffle assez puissant pour élaborer des « machines de guerre » placées contre le pouvoir en place. Mieux, le pouvoir essaye de les récupérer au risque qu’ils deviennent des discours actifs de ce même pouvoir. Voyez Lacenaire, ce grand criminel dont on a fait paraître pendant longtemps ses Mémoires en oubliant d’y ajouter ses remarques subtiles sur les méfaits du pouvoir, de son fonctionnement.
Si bien que Foucault a l’impression qu’il faut changer de stratégie combative. Reculer pour mieux avancer. Si chaque fois que je lutte contre un pouvoir, je ne rencontre que la face hideuse du pouvoir, il faut que je puisse détourner le regard de la méduse. Foucault va donc ménager sa conception du pouvoir, sans pour autant la supprimer.
1978, Paris : Le philosophe et le pouvoir pastoral
C’est dans l’idée de « gouvernement », que Foucault trouve la reformulation de sa conception du pouvoir. Au lieu de s’opposer au pouvoir, Foucault cherche plutôt la manière de le « contourner », « d’y échapper » sans le détruire, et sans le fuir.
Par « gouvernement », Foucault n’entend pas comme on se l’imagine aisément l’ensemble des ministres et du Premier Ministre, mais une réélaboration de la notion de « pouvoir » entendu maintenant comme « la manière de conduire la conduite des autres ».
Le pouvoir n’est plus seulement ce qui normalise la société à la façon de rapports de forces qui l’articulent à tel ou tel discours, comme pour le pouvoir moderne, le discours des sciences de l’homme. Le pouvoir est maintenant conçu comme « un guide », c’est lui qui « conduit » l’individu à ce discours psychologisant, dont on parlait au début. Le pouvoir devient moins statique : il ne s’impose plus à l’individu, comme un vêtement qui lui collerait à la peau. Il est un processus qui façonne l’individu lui-même. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?
Le pastorat apparaît lorsque surgit le problème de la « population ». Le XIXe siècle, c’est le siècle de Malthus. Le siècle où l’Etat se demande comment gérer le flux de natalité, des migrations. Le pouvoir qui était depuis le XIXe siècle une souveraineté fonctionnant autour du Roi se mue alors en pastorat : il devient un guide, qui se dote d’une police, de mutuelles d’assurances, d’hôpitaux. Son but est de « conduire » une population selon ses intérêts. Assurances, hôpital, police : tout est fait pour le salut de l’individu.
L’Etat-providence, la sécurité sociale sont des inventions de ce « bio-pouvoir ». Le pouvoir pastoral guide la vie des individus : c’est pourquoi c’est un « bio » - (vie en grec) pouvoir. Alors qu’auparavant, à l’époque de la monarchie, c’était le droit de vie et de mort qui prévalait, aujourd’hui, l’Etat veut protéger ses citoyens. On dira que c’est bien, tel n’est pas l’avis de Foucault. Là où on voit un progrès dans « l’expérience de l’hôpital », voire dans la « sécurité sociale », Foucault ne voit que la ruse du pouvoir. Une façon pour le pouvoir de mieux cerner l’individu dans sa vie. Bref de le « surveiller », de le « contrôler ».
Plus nous nous abandonnons au pouvoir, plus nous nous laissons prendre en charge (cela va du RMI au sacrifice obligatoire des « appelés » à la guerre), moins nous sommes libres, c’est-à-dire résistant au modelage de nous-mêmes. Le pouvoir est un « œil » qui cherche à regarder en nous et nous oblige à voir ce que lui veut que nous voyons : sa survie, sa perpétuation, et non notre asservissement.
Le pouvoir est donc un pasteur et nous sommes des moutons. Foucault serait alors, critiquant le pouvoir, une brebis galeuse ?
On retrouve, dans cette description du pouvoir, quelque chose de très ancien. Le pouvoir moderne a repris un vieux modèle de pouvoir déjà présent dans l’Antiquité : celui utilisé par Moïse pour conduire le peuple hébreu vers la Terre promise.
Moïse a pour tâche de sauvegarder le troupeau de Dieu. C’est un devoir qu’il a envers Dieu et ses brebis. Contre les lectures habituelles qui insistent sur l’aspect juridique de l’Alliance entre Dieu et son peuple, plus propre à préfigurer le pouvoir monarchique – pouvoir d’un Roi envers ses sujets - que le pouvoir moderne, Foucault comprend plutôt la conduite de Moïse comme celle d’un guide, et non d’un maître.
Pour Foucault, c’est la conduite de Moïse qui explique comment le peuple Juif ne s’est pas révolté durant les 40 années d’errance dans le désert, plus que la Loi des commandements (que d’ailleurs les Hébreux ont d’abord rejeté – comme le montre l’épisode du Veau d’or). Le discours qui prévaut alors c’est le discours de la promesse, de l’attente (discours de Dieu).
Certes, le pastorat mosaïque n’est pas aussi complexe – dans ses procédures, ses stratégies – que le pastorat moderne. Il faudra du temps et l’avènement du christianisme pour donner à ce pastorat juif la forme de « l’examen de conscience ». Plus l’individu se pose la question de son identité, et plus il se soumet au pouvoir.
Ainsi, ce qui d’abord (à l’époque de la Bible) ne s’appliquait qu’aux âmes pour leur salut, en vue de glorifier Dieu, s’applique aujourd’hui au niveau des corps pour leur santé, en vue de glorifier le pouvoir lui-même. Préserver l’individu - et la « population » - c’est pour le pouvoir moderne, une façon de se protéger lui-même. En agissant pour l’individu, le pouvoir agit pour lui. A la limite, à toute époque, c’est le pouvoir qui cherchait à se conserver : tantôt en arborant le discours de la religion, tantôt d’autres discours comme celui de l’homme.
1978, Iran : Une expérience journalistique et politique
Mais Foucault n’a pas définitivement « rompu » avec les formes politiques d’opposition telles que les proposent les philosophies socialistes. C’est du moins ce que suggère l’expérience politique qu’il fait cette année-là, en Iran.
Un journal italien, Corriere della serra, lui demande de raconter la révolution iranienne en cours : le Shah vient d’être renversé par Khomeiny, un Imam, chef spirituel pour les musulmans. Foucault, on le lui reprochera, salue cet événement : « A l’aurore de l’histoire, la Perse a inventé l’Etat et elle en a confié les recettes à l’Islam : ses administrateurs ont servi de cadres au Calife. Mais de ce même Islam, elle a fait dériver une religion qui a donné à son peuple des ressources indéfinies pour résister au pouvoir de l’Etat. Dans cette volonté d’un gouvernement islamique, faut-il voir une réconciliation, une contradiction, ou le seuil d’une nouveauté ? (...) J’entends déjà les Français qui rient. Mais je sais qu’ils ont tort » (A quoi rêvent les Iraniens ?, Le Nouvel Observateur, 16 octobre 1978). Foucault voit dans la nouvelle Persépolis une véritable révolution. Un pouvoir est renversé, et c’est pour le coup, un mouvement populaire et religieux qui se mue en gouvernement. Mais après quelques semaines, Foucault s’aperçoit qu’il s’est trompé. Des reproches viennent de tous côtés ; eût-il été journaliste que personne ne lui en aurait tenu rigueur. Mais Michel Foucault est « le philosophe » ! De cette expérience, Foucault sortira amer et blessé. Que peut-on dire de cette erreur ? Qu’elle est moins une erreur théorique qu’une erreur tactique : Foucault s’est laissé « prendre » entièrement par l’événement.
Foucault a t-il été fasciné par la figure de l’Ayatollah ? Certainement. Il n’a pas imaginé que le stratège - le politique - pouvait prendre l’habit du prophète. Mais il a bien vu que cet élan religieux n’allait pas disparaître de sitôt. Foucault s’est-il pris à son propre jeu (d’apprenti journaliste) ? Non. Foucault sait bien qu’il est un intellectuel. Pour lui c’est à la fois un « choix simple » et « un ouvrage malaisé » : « car il faut tout à la fois guetter, un peu au dessous de l’histoire ce qui la rompt et l’agite et veiller un peu en arrière de la politique sur ce qui doit inconditionnellement la limiter » (Inutile de se soulever ?, Le Monde, 11 mai 1979 ). Foucault s’est consacré à l’événement qu’il avait sous les yeux, avec le regard d’un intellectuel expérimentateur : il n’a pas trahi son engagement contre le pouvoir ; il a salué la chute du pouvoir du Shah comme une libération du peuple iranien. Rien de plus, rien de moins. Une chose est sûre, en tous cas : après cette expérience, Foucault apprend à se méfier de toute révolution politique.
Il reste donc à se demander, après avoir décrit le complexe « Savoir-Pouvoir » de notre époque (qui fait de nous des « sujets », des individus cherchant à se penser comme des êtres de désir), et aussi son effroyable capacité d’enfermement, comment lui échapper. L’ancienne conception du pouvoir pouvait laisser croire que le contre-pouvoir n’avait pas finalement de « prise » véritable contre le pouvoir. Comment lui échapper, lui qui est partout ? Contre le pastorat, conception plus souple, Foucault imagine des formes de gouvernement d’opposition. Comment se défaire du pastorat sinon en le contournant, en mettant en œuvre un gouvernement de soi, une conduite de soi-même, sur laquelle le pouvoir ne puisse plus s’appuyer. Foucault passera les dernières années de sa vie – jusque 1984 – à réfléchir à son éthique, c’est-à-dire à une lutte véritable contre le pouvoir. Car ce qui est en jeu pour Foucault, c’est la liberté de l’individu. Libre ne veut pas dire : libre de tout savoir et de tout pouvoir, mais libéré d’un savoir qui identifie et d’un pouvoir qui enferme.
1981, Etats-Unis : La vie comme œuvre d’art
1981 : changement d’horizon. C’est sur les plages californiennes qu’il côtoie fréquemment à cette époque que Foucault commence son analyse de la «gouvernementalité» - un «rapport à soi» capable d’échapper, de «doubler» le pouvoir: ce sera sa dernière «grande» originalité, avant sa mort, en 1984. San-Francisco est pour lui un lieu idéal: une véritable culture gay s’y élabore. Il songe sérieusement à arrêter l’enseignement au Collège de France pour y mener une vie plus paisible. En attendant, il donne quelques conférences à Berkerley, notamment.
Que voit-il dans ce paradis américain ? Assurément, beaucoup plus qu’une liberté sexuelle, comme on l’a souvent cru : affirmer sa sexualité, c’est pour Foucault avouer «sa vérité», décliner encore une fois ce «savoir» psychologique qu’il n’a cessé toute sa vie durant de critiquer comme «désir». Car c’est le désir qui constitue le discours de l’Occident, ce «savoir» qui s’est imposé à l’individu depuis le Moyen-Age. C’est le désir qui s’affirme autant dans la liberté sexuelle des années 70, que dans l’aveu des péchés dans le confessionnal, ou que dans le discours amoureux de la dame pour le preux chevalier, ou encore dans le discours de la psychanalyse: à chaque fois on retrouve le même discours, comme point d’articulation du gouvernement. A chaque fois, il nous faut toujours reconnaître notre désir comme vérité de ce que nous sommes. Là se constitue, pour nous Occidentaux, notre identité. En ce sens, on comprend pourquoi c’est surtout dans la «psychanalyse» que Foucault concentre sa critique. Lacan confirmera l’analyse foucaldienne en pensant l’affirmation du désir comme «vérité du sujet». Cette culture rencontrée en Amérique n’est pas la marque pour Foucault d’une norme du pouvoir, d’un gouvernement de certains individus. Cette identité selon Foucauld échappe au pouvoir: Cette gouvernementalité, ce «souci de soi», comme dit encore Foucault, échappe aussi à un discours simplement contestataire, simplement anarchiste: discours qui est la marque d’un certain humanisme, ou au contraire d’un individualisme forcené.
Dans cette «vie californienne», Foucault voit l’illustration d’une véritable lutte contre le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que toute forme de cette culture soit «libératrice», non plus qu’il n’y ait pas d’autre forme de libération. L’idée du mariage gay, par exemple, est une aberration que l’on peut, en suivant Foucault, dénoncer. Car le gay qui veut se marier cherche à reproduire la norme, il se nie en tant qu’individu.
De même, la libération sexuelle qui recherche plus l’affirmation d’une identité (comme le féminisme qui désire imposer la Femme à partir de la norme dominante de l’Homme ) que la production de nouvelles formes de rapport à soi est à dénoncer : au contraire, l’ars erotica des Chinois, des Japonais, fondée sur la recherche du plaisir, remplace la recherche narcissique du désir.
Ainsi, contre ces identités fixes du désir - car elles perdurent au fil des siècles et s’imposent de plus en plus à l’individu de la société -, Foucault cherche à «expérimenter» des identités dynamiques. Son travail est donc bien au bout du compte de nous enlever toute identité déterminée, façonnée, instruite par un pouvoir. Seules des conduites créatrices permettent à l’individu d’échapper aux normes.
Références :
De Michel Foucault, notamment :L’Herméneutique du sujet, quatrième tome des Cours au Collège de France .Les Dits et Ecrits : une réédition plus pratique et moins coûteuse vient de paraître.Sur sa vie et son œuvre :D.Eribon,
Michel Foucault, Champs-Flammarion, 418 pages.
D.Bellahcène,
Michel Foucault et le savoir-Pouvoir, thèse de doctorat de Philosophie, Université Paris VIII, 2004.
D.Bellahcène,
Elogio de la discontinuidad: Foucault y la apertura de la historia a la verdad, Ed. Perro y la rana, Cararcas, 2007.