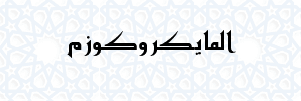Si la vitalité de la démocratie s'appréhende à l'aune de la multiplicité des partis, c'est sans doute que ceux-ci semblent être à même de préserver les clivages, les différences et finalement l'hétérogénéité de la société. La pluralité des partis ferait signe dès lors vers une autre pluralité, celle des individus inclus dans le cercle de la polis. Les partis en ce sens sont la résolution apportée par le régime démocratique à la contradiction des opinions. Ils expriment la dialectique du particulier (la somme des individus) et du général (le bien commun). C'est la première signification que l'on pourrait attribuer au lien théorique qui unit les partis à la démocratie, c'est-à-dire leur nature de lieu spéculaire de la société toute entière.
Mais si la démocratie identifie l'exercice d'un pouvoir dont le foyer est le peuple, à la fois dans son origine, son exercice et sa destination, le parti s'appréhende dans une perspective moins transparente et peut-être polémique (au sens d'une opposition conflictuelle) par rapport à la démocratie. En effet, les partis apparaissent moins comme une médiation entre le peuple et l'exercice du gouvernement que la déperdition du lien entre le peuple et le pouvoir. Condensé dans les mains de quelques-uns, délié de la sphère civile, le pouvoir circule, s'échange, se transmet dans un la sphère très restreinte de l'espace partisan selon des règles qui ont peu à voir avec le jeu démocratique.
Les partis devraient manifester la possibilité pour chaque citoyen de quitter le domaine privé pour investir le champ du public, participer à la délibération commune, à l'élaboration d'une unité qui subsumerait les conflits particuliers. Ils semblent à l'inverse renforcer la dichotomie du peuple et de ses dirigeants, des gouvernés et des gouvernants. Vestige d'une aristocratie ou rémanence d'une oligarchie qui ne dirait pas son nom, le système des partis semble donc partager son sort avec la démocratie en même temps qu'il paraît la pervertir de l'intérieur.
Cette ambivalence fondamentale voire essentielle des partis, à la fois médiation et obstacle dans l'espace démocratique, doit-elle être considérée comme l'aporie irréductible sur laquelle vient buter la théorie du pouvoir dans le système démocratique, ou à l'inverse peut-elle se donner comme la condition de possibilité de la démocratie, qui demeure un horizon de la pratique politique des partis?
Nous verrons comment le système partisan peut s'entendre comme un "symptôme" de la démocratie. Pourtant, l'analyse interne du parti ne désigne-t-elle pas celui-ci comme un organisme exogène au biotope que représenterait la démocratie? Enfin, si la dialectique du singulier et du pluriel, de l'individuel et du général semble bien constituer la structure intime du parti, celui-ci ne peut-il être comme la chance de la démocratie, c'est-à-dire le moyen de son effectivité dans l'espace politique?
L'apparition des partis ne va-t-elle pas de pair avec l'invention de la démocratie moderne, c'est-à-dire non plus directe, comme chez les Grecs ou dans la société rêvée par Rousseau, mais représentative? C'est bien une nouvelle conception du monde et de l'espace politique qui apparaît avec la naissance des partis. Le parti désigne, en effet, le partial et donc, comme la partie, le partiel. Il est un élément du tout, une de ses composantes qui, en conséquence, se tient sur le territoire précaire du relatif. Le parti ne peut prétendre à l'absolu ou à la globalité, même s'il tend à réaliser son projet dans la sphère du général et de l'universel. Faire triompher ses idées, ce n'est finalement rien de moins que faire reconnaître leur universalité, leur caractère opératoire au delà de la vision partisane elle-même. Pourtant, avant d'être cela, le parti est l'affirmation d'une nouvelle conception du monde dans l'espace politique. La vérité est rejetée hors de celui-ci.
Avec le parti, c'est l'opinion qui devient la règle de l'action, et sa confrontation avec d'autres, opinions antagonistes. Le bien commun en ce sens n'est plus le produit des savants, tel que le voyait Platon, mais la construction laborieuse des politiques, c'est-à-dire, la rencontre polémique de points de vue. Le parti rejette la vision synoptique et préfère le point de vue. Avec la naissance des partis émerge une nouvelle idée, celle d'une pratique politique où le bien de la cité ne résulte pas d'une vérité à découvrir mais d'un débat à mener pour élaborer dans le processus même de la contradiction l'intérêt général.
D'une certaine façon, la vision aristotélicienne de l'homme prudent vient prendre le pas sur la conception platonicienne de la politique comme science. Le parti en ce sens est l'affirmation de l'autonomie de l'homme, son habilité à construire l'ordre commun. Il manifesterait le passage d'une transcendance (un ordre immuable, que l'on atteindrait par la recherche de la vérité en politique) à une immanence (l'homme et sa raison pratique, ce que Aristote nommait la phronesis et dont il faisait l'attribut essentiel du sage en politique).
Cela ne signifie pas pour autant que cette opinion avancée par les partis n'est pas posée en tant que vérité. L'absolu n'existe pas, la cité idéale, le rêve platonicien d'un ordre parfait ici-bas qui serait la correspondance d'une harmonie supérieure, se brise sur cette conception pragmatique de la cité. La vérité change de signification: elle est une construction, un horizon, et non plus une réalité anhistorique. Elle apparaît non pas selon un principe inductif coupé de tout contexte social, économique ou historique mais comme création humaine: volatile, précaire, et toujours en phase de reconstruction.
On reconnaît implicitement avec l'établissement du parti dans la vie politique que c'est dans la confrontation du partial et du partiel que l'ordre commun peut s'édifier. Mais partis et démocratie ne nourrissent-ils pas des rapports d'homologie? Le cercle de la démocratie se bâtit dans la rencontre de l'un et du multiple. Comment résoudre l'hétérogénéité des individus et la construction, seule et unique du bien commun? Comment faire passer les voix discordantes des membres d'une société à l'harmonie d'un accord, au sens quasi musical du terme? Le danger de cette situation polémique, c'est de faire sombrer toute stabilité politique par la remise en cause perpétuelle des socles de l'espace politique. Comment rendre possible à la fois le débat et la continuité de l'Etat?
Le surgissement des partis dans l'espace public, que l'on peut sans doute lier à la mort des factions et à la reconnaissance définitive de la légitimité de l'Etat, a permis l'intégration des partis en tant que tels et une institutionnalisation du débat. Le problème des partis se lie en effet indissolublement dans ses origines avec la question de la légitimité du régime. L'existence des partis, c'est l'idée que le régime dans ses fondements ne peut plus être remis en cause, mais que ses mécanismes, ses orientations sont au contraire entièrement ouvertes à la réformation, voire la contestation la plus radicale. On aperçoit ici comment le parti surmonte l'aporie que représentaient les factions, qui mettaient véritablement en péril la "sûreté de l'Etat". Il condense et rapatrie les virtualités de violence contenues dans les émeutes de l'Ancien Régime, les contestations rurales, les émotions populaire élargies hors des cadres des provinces au XVIIè siècle. Autrement dit, le régime démocratique s'entend dans sa préexistence politique au phénomène partisan: il en prépare la possibilité et l'avènement.
Mais s'ils permettent de ménager une place au débat contradictoire, les partis autorisent en même temps la réduction de l'hétérogénéité. Parce qu'ils sont pluriels, ils assument ce passage du multiple à l'un. Ainsi, lorsque la pluralité ne caractérise plus le système des parti, lorsque le "s" de "partis" disparaît, le parti devient le Parti, c'est-à-dire non plus l'émanation des individus, mais, dans un mouvement inverse, celle du pouvoir. A contrario de l'expérience totalitaire qui s'appuie sur le régime du parti unique, un rapport d'homologie semble bien s'établir ici entre les significations partisane et démocratique.
L'URSS stalinienne, celle de la consolidation du pouvoir après la seconde guerre mondiale, le montre assez. Dans un discours du 9 février 1946, Staline déclare: "la seule différence entre les militants du Parti et les sans-parti, c'est que les uns sont membres du Parti et les autres ne le sont pas." Cercle tautologique et exclusif, le Parti totalitaire absorbe la société, et rapatrie le social dans le politique comme les théocraties fondaient le profane dans le sacré. La disparition de l'idée démocratique à partir du communisme de guerre, et peut-être même avant, va de pair avec le renforcement hégémonique du Parti (perspective externe) et son monolithisme (perspective interne). En 1977, le passage de Khrouchtchev au pouvoir n'a pas changé les choses: la Constitution livre une définition du Parti et le légalise: il est "la force dirigeante et le Guide de la société soviétique, le noyau de son système politique, de l'Etat et de toutes les organisations sociales." Piatakov écrivait de même dans la Pravda, le 23 décembre 1929: "Il est absolument clair qu'on ne peut pas être pour le Parti et contre la direction actuelle, pour le CC et contre Staline."
Ce n'est pas tant la structure partisane qui assure l'échange démocratique que la pluralité partisane. Si l'on reprend l'appellation établie des inputs et des outputs, on remarque que ces fonctions assumées pour les uns par les partis et pour les autres par les structures gouvernementales et parlementaires dans les systèmes occidentaux étaient réunis dans les seules mains du Parti en Union soviétique.
La dimension particulière des partis situés à l'intersection de la multitude non organisée politiquement et le pouvoir, nécessairement un pour garder son efficacité, est celle de la médiation et de la réduction: il médiatise la multitude et l'hétérogénéité des voix et réduit leur ampleur à un discours unique. Il enterre donc le mythe de la démocratie directe et tente d'établir, avant la représentation politique des individus la représentation institutionnelle des opinions. Le parti en ce sens pourrait apparaître comme la tentative de résolution de l'aporie que constituerait la démocratie directe des Grecs ou l'impossible délégation des pouvoirs chez Rousseau.
Les partis sont le microcosme spéculaire de la démocratie: un peuple que composent les militants, un bureau politique avec une structure hiérarchique qui refléterait celle du gouvernement dans la cité démocratique, des processus d'élection, de représentation et de délégation définis précisément par des statuts qui seraient l'écho d'une constitution démocratique. Pourtant, autant d'un point de vue interne que d'un point de vue externe, le parti fait problème dans un espace démocratique.
L'organisation des partis est-elle démocratique dès lors que les convictions des individus et leur autonomie sont prises dans un parti-machine qui impose une structure, une régulation, un ensemble de contraintes?
On remarque que les dissensions et les débats internes sont dissimulés, que les voix hétérogènes des opinions se résorbent dans celle de son porte-parole. C'est l'une des idées essentielles développées par Mosiei Ostrogorki dans son ouvrage La Démocratie et les partis politiques. Une analyse des partis politiques français peut lui donner pour partie raison. Les principaux mouvements politiques historiques en France (l'UDF, le RPR, le PS et peut-être encore davantage le PC et le FN) tentent d'élaborer un consensus, en tout les cas d'en donner l'image apparente.
Le cas atypique des Verts, formation encore militante en voie d'institutionnalisation avec leur première expérience du pouvoir, est révélateur. En son sein se joue de manière continue, et quasi structurelle, une dialectique du multiple et de l'unité, de la contestation et de la normalisation, comme si la cacophonie semblait toujours devoir être comprimée dans l'harmonie d'un discours monovalent. Les voix des dirigeants et les voix des militants semblent poser une réalité particulière, comme une figure de l'exception: la partie l'emporte sur le tout, l'individualité sur la totalité. Cette dialectique oppressive du tout sur la partie éclaire la téléologie partisane, qui s'oriente moins vers l'épanouissement de la démocratie dans la cité que vers ses propres projets: son achèvement interne (la résolution du conflit unité/pluralité) et externe (la captation du pouvoir).
C'est dire que si le biotope des partis est la démocratie, son organisation métabolique est hétérogène à ce milieu de vie. Celle-ci produit une espèce de raison régulatrice qui ordonne de se conformer. Dans l'ordre du tout, la partie n'a pas forcément voix au chapitre. Dans la société de pensée que constitue le parti, l'individu doit pouvoir sacrifier ses opinions personnelles et certaines exigences de la morale pour considérer pragmatiquement ce que les obligations et les contraintes de son organisation exigent.
L'histoire politique de l'Espagne en porte un témoignage éclatant. Entre 1875 et 1923, la vie politique espagnole était engluée dans un règne antidémocratique où le corps électoral ne détenait qu'une fonction passive. La circulation verticale du pouvoir ne partait pas du bas vers le haut mais des Cortès vers l'électorat en raison des accords préalables entre les chefs des partis conservateur et libéral qui exerçaient le pouvoir en alternance et de négociations entre ceux-ci. Ainsi, des notables locaux, ceux qu'on appelait les caciques, se chargeaient à leur tour de manipuler le processus électoral. L'entreprise était simple : contenter les membres de chaque parti pour éviter que les mécontentements n'en rompent l'unité, mais sans exaspérer les clientèles opposées au point de susciter chez elles un esprit de revanche. Le fonctionnement du système espagnol trouve ici ses règles dans un code non écrit.
Mais alors si le parti opprime plutôt qu'il exprime, n'est-ce pas parce que se noue dans la structure partisane une organisation contraire à la distribution démocratique du pouvoir? Avec le système partisan surgit la menace oligarchique. On voit donc comment se retourne la perspective qui voyait dans la pluralités des partis l'expression intime de la démocratie: loin de renvoyer l'image des débats contradictoires, des opinions divergentes, le parti a la structure du "top down" et non du "bottom up". Le principe structurant vient d'en-haut et non pas d'en bas. N'est-ce pas dès lors saisir la structure partisane comme une structure non plus seulement hiérarchique mais oligarchique?
Coupée de sa fraction militante, elle-même soumise aux "ordres venus d'en haut", cette caste concentrerait dans ses mains le pouvoir, la production des idées, la médiation avec l'extérieur: cette frange, cette élite opère ostensiblement le déni démocratique de la représentativité. La vision gaullienne rend compte de cette saisie critique des partis dans la sphère démocratique. Le discours de Bayeux en 16 juin 1946, vitupère le "jeu des partis", le pouvoir au peuple contre "l'oligarchie des partis". De Gaulle a toujours combattu le système des partis, y voyant la source d'une division fatale à l'intérêt national. L'oligarchie partisane introduit la somme innombrable d'intérêts particuliers qui perturbe le libre jeu démocratique et l'invention d'un intérêt général. Le rapport partis/démocratie est donc moins symbiotique qu'antagonique. "Je vois, écrit De Gaulle dans ses Mémoires de guerre, en l'Etat rénové non point comme il l'était hier et comme les partis voudraient qu'il le redevienne, une juxtaposition d'intérêts particuliers, d'où ne peuvent sortir jamais que de faibles compromis, mais bien une institution de décision, d'action, d'ambition, n'exprimant et ne servant que l'intérêt national." Le système partisan secrète de l'oligarchie comme il génère une coupure entre les dirigeants et les militants. A terme, le parti maintiendrait plus largement une dichotomie entre les représentants et les citoyens.
Ainsi Roberto Michels écrit-il dans Les partis politiques: "Le parti, en tant que formation extérieure, mécanisme, machine, ne s'identifie pas nécessairement avec l'ensemble des membres inscrits, et encore moins avec la classe. Devenant une fin en soi, se donnant des buts et des intérêts propres, il se sépare peu à peu de la classe qu'il représente" (VI, 2). Il ajoute : "Dans un parti, les intérêts des masses organisées qui le composent sont loin de coïncider avec ceux de la bureaucratie qui le personnifie." De fait, tous les partis fonctionnent sur le principe de la sélection intérieure, qui place au sommet de l'édifice les meilleurs, les aristoi et établit une coupure radicale entre un petit groupe de dirigeants et l'ensemble des militants. On pourrait dès lors douter d'une conception qui ferait du parti le lieu de l'élaboration et de l'expression des opinions. Dès lors, le lien entre partis et démocratie débouche sur un problème: comment reconnaître l'appartenance de la structure partisane à la démocratie si la première déroge aux principes de la seconde? Car si le parti est le microcosme de la démocratie, il pose dans sa particularité, la question plus générale de la possibilité de la représentation. La démocratie n'est-elle pas somme toute un principe régulateur et conservateur qui tend à organiser des organisations figées fonctionnant sur un mode oligarchique de conservation du pouvoir? Derrière la démocratie se dissimulerait l'organisation inavouable d'un système oligarchique.
On pourrait sans doute contester cette thèse qui considère le parti d'une manière univoque alors que celui-ci peut s'entendre également comme le lieu où se réalise la médiation essentielle entre la société et le pouvoir et la fidélité de l'instance dirigeante du parti à sa base est sans doute moins importante que sa fidélité à la société toute entière. Enfin, il s'agit de distinguer, ce que R. Michels ne fait pas, démocratie partisane et démocratie politique. Certainement, la démocratie se lit à l'aune des organisations qui la font vivre, néanmoins faut-il penser pour autant qu'elle n'est manifestée que par les règles internes des partis? La démocratie n'est-elle pas plus globale, c'est-à-dire rendue visible dans le jeu des relations interpartisanes?
Mais si le parti génère une oppression des consciences individuelles, instituant une règle commune à laquelle nul ne saurait pleinement déroger, il manifeste un désengagement à la fois des chefs de parti et de la masse. Celle-ci s'en remet à ses dirigeants et, en lui accordant sa confiance, lui donne également son pouvoir. Le chef devient le simple porte-parole d'une immense machinerie. Les consciences des dirigeants se dissout.
Plus la fonction du parti est laissée indéfinie, moins sa responsabilité est engagée. Le parti entraînerait ainsi une déresponsabilisation de ceux qui font la politique dans la sphère démocratique. La responsabilité se dérobe derrière une situation politique dont ne saurait être l'origine une seule personne, derrière des situations sociales ou économiques qui excèdent semble-t-il les dimensions du parti.
Cette difficulté appelle une réflexion politique sur la question de la représentation et de la délégation des pouvoirs. C'est un problème classique de la philosophie politique. La raison n'engage-t-elle pas à choisir dans le processus de l'élection les plus compétents pour représenter le peuple ? L'élite n'est-elle pas nécessairement non pas une dérive de la démocratie, mais sa conséquence la plus immédiate ? En ce sens, la démocratie serait une aristocratie, au sens étymologique du terme. C'est-à-dire le régime des meilleurs, des aristoi. En France, l'ENA a été créée dans cette optique de fournir à la nation des spécialistes, des aristoi. A partir du moment où le rêve de la démocratie directe s'abolit, apparaît la noblesse d'Etat.
Il y a là une aporie (un régime, la démocratie, reposant sur un fondement, l'aristocratie, qu'elle récuse) qui doit être dépassée parce qu'elle est sous-jacente à une idéologie de la rationalité en politique qui entraîne la justification de l'irresponsabilité et l'implicite : l'immaturité du peuple à se gouverner lui-même. L'idée, derrière cela, c'est celle de la légitimité d'une classe, les élites, la noblesse, d'Etat. Le champ politique serait le champ réservé aux experts, qui gomme ainsi toute idéologie (socialisme, libéralisme, conservateur, nationaliste). Comme il n'y a plus de principe d'action structurant, sinon cette rationalité qui ne parle pas, il est devenu commode de légitimer l'impuissance. Les prémisses théoriques de la réforme sont donc la lutte contre cette idéologie technocratique.
Autrement dit, l'affirmation du parti dans la sphère du politique se doublerait, selon cette hypothèse, d'une négation des trois fondements de la démocratie : la compétence du citoyen, la légitimité du représentant, c'est-à-dire sa représentativité, et enfin la possibilité de la pluralité, c'est-à-dire la conciliation du particulier et du collectif, de l'individu et de son agrégation avec un groupe.
C'est pourtant la situation charnière des partis politiques, à la fois exogènes et endogènes au pouvoir, à la fois hors du peuple et émanation du peuple, à la fois dans le champ du privé et dans celui du public, qui constitue la dialectique intime d'organisations au service de la démocratie. Le parti doit moins se concevoir dans son hétérogénéité apparente aux principes démocratiques, principes de fonctionnement mais aussi principes entendus au sens d'idéal de gouvernement de la masse par la masse, que comme une instance de médiation capable d'organiser une société caractérisée par les dissensions.
La difficulté essentielle pour un parti politique tient à sa position d'entre-deux, d'intermédiaire entre le politique et le social, de porte et de pont entre l'individuel et le collectif. Le parti politique réalise, dans le projet démocratique de gouvernement du peuple par le peuple, le passage du privé au public. En effet, si le parti politique entreprend de revendiquer les intérêts de la société et de conquérir le pouvoir, il est aussi, dans un domaine qui aurait plus à voir au privé qu'au public, le lieu d'agrégation d'individus aux mêmes idéaux et aux mêmes principes C'est d'ailleurs dans les partis les plus extrêmes, notamment de gauche, qu'une porosité s'établit: il n'est pas exclu que le parti puisse s'immiscer dans la vie privée; pour gouverner les esprits, on gouverne aussi les corps.
Il y a ici un parallèle à faire entre l'opinion et le parti : de même que celle-là n'a pas en elle-même d'autorité, de même le parti ne peut détenir une autorité qui serait celle de l'Etat. Loin d'être une institution publique, il est, comme la plupart des législations nationales le désignent, une simple association d'ordre privé. Si les Grecs établissaient une claire séparation entre le domaine privé et le domaine public, la modernité a progressivement dissous cette distinction, en confondant toujours davantage la société et l'Etat. Le parti précisément cristallise cette situation d'entre-deux : la démocratie lui est à la fois extérieure et intérieure, comme la pratique politique, qui est à mi-chemin du privé et du public. En ce sens, le parti s'oppose à la démocratie parlementaire, en ce qu'il réduit la distance des citoyens au pouvoir. Ceux-ci se trouvent rapprochés de lui par l'intermédiaire. Ils peuvent prendre part idéalement aux décisions prises. Il est le reflet de la société dont il essaie de capter les certains traits qu'il tente de rendre à l'identique. Mais en même temps il est une réalité toute entière tournée vers l'Etat et le pouvoir. C'est son ambivalence et le symptôme de la démocratie qui peine à articuler le politique et le social. Les partis sont traversés par cette ambivalence qui fait la position difficile de la démocratie et sa chance de faire intervenir tous ses membres.
Sans doute les partis doivent-ils désormais s'entendre comme le lieu d'articulation de la société civile et la société politique. Les partis assument le rôle de nœud entre l'activité civile et la représentation de l'opinion. Ils rendent effective la séparation du civil et du politique en même temps qu'ils permettent leur rencontre pour que surgisse le pouvoir dans la cité et sa légitimité. En même temps, ne peut-on penser que les partis jouent le rôle pédagogique ou, au sens étymologique, démagogique de formation et d'apprentissage du citoyen. Il fonctionne comme la métonymie du régime dans lequel il s'intègre. S'il manifeste les traits particuliers de la démocratie, il compose également avec ses défauts, ses tendances et ses dérives. Sa dimension ambivalente, à mi-chemin entre la sphère privée de l'association et le domaine public du pouvoir et de son exercice, en fait la matrice de la possibilité démocratique. Il est une invitation, une participation à l'action publique.
On remarque donc que le système partisan ne se conçoit pas nécessairement par opposition au système démocratique. La démocratie ne se juge pas tant à l'aune des principes internes des acteurs qui la font vivre que dans les relations externes qui unissent ces acteurs. Comme dans le modèle économique, le jeu démocratique fonctionne sur le principe de l'offre et de la demande sur un marché qui assure l'ajustement nécessaire : ce sont les candidats et les programmes des partis qui représentent l'offre. De l'autre côté, les aspirations des électeurs et les ajustements par le scrutin représentent la demande. On pourrait critiquer cette approche en ce qu'elle réduit la vie politique à sa dimension instrumental et l'élection à une simple procédure. Pourtant, elle montre bien que le système partisan, comme la structure du marché, assure un processus, bien plutôt qu'il ne réalise un idéal. Le parti est un organe de la démocratie, c'est-à-dire au sens étymologique, un outil qui crée la possibilité d'une transformation du réel, d'une praxis.
Les rapports qui se nouent entre les partis politiques et la démocratie prennent de multiples formes, à la fois d'homologie et d'hétéronomie : d'une part, les partis sont les reflets spéculaires du régime démocratique dont ils reproduisent, dans leur microcosme, les processus et les faiblesses; d'autre part, les partis apparaissent comme des obstacles, en maintenant au cœur du système démocratique des rémanences exogènes telles que l'oligarchie, l'aristocratie et la primauté du tout sur la partie.
Cette double nature doit être conservée puisqu'elle témoigne de la nature ambivalente essentielle des partis: entre l'individu et le peuple, entre la domination et le pouvoir, entre le privé et le public, entre la conformation et la contestation. C'est précisément cette situation d'entre-deux qui permet de saisir la situation particulière du parti dans la démocratie: il est dans la démocratie; il est aussi hors de son jeu pour autant qu'il la réforme.
Le système des partis permet d'ordonner des discours hétérogènes qui doivent nécessairement être domestiqués pour que se maintienne un espace démocratique. Domestiqués, c'est-à-dire annexés, intégrés constitutionnellement dans la construction démocratique pour ne pas mettre celle-ci en danger. Autrement dit, si leur fonctionnement interne peut stigmatiser les dérives de la démocratie, telle que la non-circulation du pouvoir qui revient toujours aux mains de quelques-uns (oligarchie), les meilleurs (aristocratie), et les plus anciens (gérontocratie?), les partis permettent de normaliser la violence idéologique et de l'intégrer dans l'espace de construction de la démocratie.
Nicolas Larnaudie